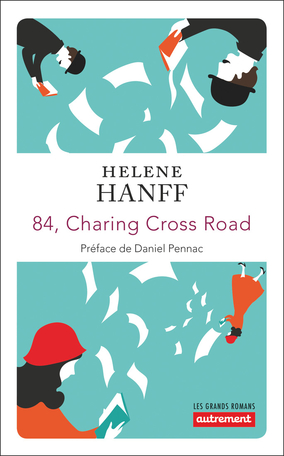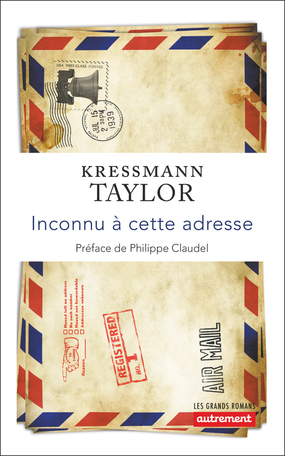Hommage à David Lodge (1935-2015) – suite et fin
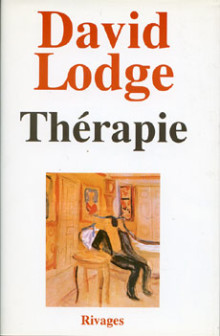
—
Par Catherine Chahnazarian
Ça m’ennuierait d’achever cette série spéciale sur David Lodge sans vous parler de Thérapie. Mais je n’ai pas pris le temps de relire ce roman et peut-être que c’est un peu exprès. C’est un de mes meilleurs souvenirs de lecture de toute ma vie et j’ai peur d’y toucher.
Le héros, cette fois, travaille pour la télé. Il traverse une crise existentielle dont le lecteur découvre les détails réalistes et pathétiques dans le journal qu’il tient (le héros, pas le lecteur, évidemment) – sachant que toute ressemblance avec vous-même ou des amis à vous sera forcément fortuite !
Comme souvent, Lodge est sans pitié avec son personnage, nous réserve des surprises et nous amuse avec une finesse exquise.
*

—
Je ne voudrais pas non plus clore cette série sans vous parler d’au moins un de ses essais sur la littérature – que David Lodge a enseignée à l’université de Birmingham pendant près de trente ans, de 1960 à 1987. Il y en a un qui est traduit en français et qui n’est pas épuisé.
L’art de la fiction est en fait constitué des chroniques que l’auteur a publiées chaque semaine dans l’Independent on Sunday (journal britannique) pendant toute une année. Il ne s’adresse donc pas ici à un public universitaire. Il n’emploie le vocabulaire technique que lorsqu’il est nécessaire et parce qu’il faut appeler un chat un chat. Spontanéité du discours, clarté et valeur du contenu – sans prétention, sans hauteur, sans lourdeur non plus. Il faut seulement que les coulisses de la littérature vous intéressent.
Chaque chapitre commence par deux ou trois courts extraits d’auteurs britanniques ou américains célèbres, donnés en version originale puis en français. Lodge s’y adosse ensuite pour développer son sujet : « Le suspense », « Le monologue intérieur », « La présentation d’un nouveau personnage », « Le roman expérimental », « L’allégorie », « Le titre » ou « La structure narrative »… Il y a ainsi cinquante chapitres passionnants à prendre dans le sens et au rythme que vous voudrez.
Si vous aimez écrire, vous y trouverez sûrement quelques tips !
*
David Lodge
Thérapie
1995
Seule la version numérique est disponible chez Payot & Rivages, dans la traduction de Suzanne V. Mayoux
L’art de la fiction
1992
Traduction française : Michel et Nadia Fuchs pour les Éditions Payot & Rivages
(2014 pour la dernière édition de poche)