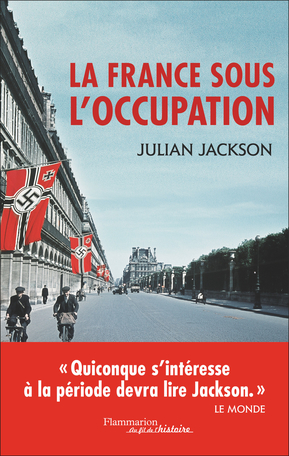On a tellement aimé Veiller sur elle (Prix Goncourt 2023) qu’on a décidé de lire les premiers romans de Jean-Baptiste Andrea, qu’on ne connaissait pas. D’où cette mini-série « On a lu tout Jean-Baptiste Andrea » — en attendant le prochain.
Littérature française
Catherine Chahnazarian
Non seulement j’ai dévoré tous les Jean-Baptiste Andrea, et donc celui-ci aussi, mais ils ont résisté à des lectures rapprochées sans me lasser de l’auteur.
Des diables et des saints se passe dans un orphelinat perché dans les Pyrénées, prison qui ne dit pas son nom, un de ces établissements dont les méthodes éducatives de « bons » catholiques ont fait la preuve de leur bêtise, de leur brutalité, de leur perversité. Le narrateur figure parmi des orphelins captifs, brimés, qui attendent leur majorité avec plus ou moins de résignation, en développant parfois de la violence, parfois aussi des rêves.
Andrea a sa façon à lui de traiter le sujet, en l’enveloppant de la personnalité de son personnage principal, le narrateur, qui ne se laisse ni identifier par son statut d’orphelin maltraité, ni regarder comme un être brisé ; et en attribuant une place authentique à la musique, touche originale qui n’affaiblit pas le sujet mais s’y fond au point que, entrant dans une gare quelques jours après ma lecture, j’ai frissonné en voyant le piano dans le hall…
Parmi les autres personnages, un garçon pas comme les autres rappelle, il est vrai, le héros de Ma reine, mais cela ne m’a pas gênée. Cette fois, l’auteur nous demande de regarder le simple d’esprit de l’extérieur et de faire notre choix : l’ignorer, nous en moquer, le plaindre ou l’accompagner. La montagne est prise à nouveau comme lieu d’isolement et de dangers, mais ça non plus ne m’a pas gênée, ça ne me dérange pas que l’auteur ait un décor de prédilection. Ses romans ont surtout la beauté pour point commun, celle de la nature (paysages, pierre, vents…), celle que l’art génère (le héros des Diables et des saints est musicien, celui de Veiller sur elle est sculpteur), celle de la personne que l’on aime, celle de l’amitié. Et celle de sa langue, d’une incroyable beauté et sans forfanterie d’auteur, qu’il a définitivement trouvée et domptée dans Des diables et des saints.
Veiller sur elle apparaît comme un concentré des talents développés au cours des cinq ou six années précédentes, permettant un travail de plus longue haleine, plus complexe, comme le disait François Lechat, et sans doute plus remarquable. Mais déjà dans Des diables et des saints, en n’en faisant ni trop ni trop peu, Andrea greffe sur une base assez simple une construction plus subtile qu’il n’y paraît, que rend profonde la superposition naturelle des sujets : la fragilité et la force ; le dénuement et la richesse ; les trébuchements de la vie et l’envie de vivre ; l’envie, le besoin d’être libre ; la résistance donc, et la vérité des sentiments.
*
Daniel Kunstler
À la fin des années soixante, l’influence du clergé sur la vie publique en France est en déclin, et la laïcité a irréversiblement infiltré le modèle de gouvernance. Une loi datant de 1905 avait imposé la séparation des Églises et de l’État, et la messe du dimanche n’attirait plus qu’un quart de la population de “la fille aînée de l’Église”. Cependant, dans les régions plus retirées de l’hexagone, cette même Église n’est pas près de lâcher prise sur le plan social, et il s’ensuit que des abbés de province s’entêtent à protéger les brins d’autorité qu’il leur reste.
C’est avec ce contexte en toile de fond que j’ai lu Des diables et des saints. Soyons clairs : il ne s’agit ni d’un livre didactique ni d’un roman historique. Il vise la distraction et la fluidité, ce à quoi il réussit admirablement tout en étant d’une plume remarquablement raffinée. Néanmoins, l’ambiance de l’époque nous fait apprécier le choix du lieu où se déroule l’essentiel du récit – un orphelinat dans l’arrière-pays entre Lourdes, haut-lieu du Catholicisme, et la frontière espagnole – et du personnage de l’Abbé Sénac, qui dirige l’orphelinat, ainsi que de celui de son opposé, Joe, victime de son sadisme et principal protagoniste de l’histoire. Andréa juxtapose la cruauté de l’abbé à la rudesse de l’ancien professeur de piano Rothenberg : ce dernier, malgré sa brusquerie, tenait à épauler les aspirations de Joe, alors que Sénac s’efforce de les écraser.
Des diables et des saints s’expose à des critiques somme toute assez dérisoires : la fixation un peu aléatoire sur certaines sonates pour piano de Beethoven dont les particularités échapperont à la majorité des lecteurs ; le portrait parfois un peu caricatural de « la Grenouille », homme de main de l’abbé, qui trempe parfois dans la caricature ; la vie parfaite de Joe adulte, un peu trop commode ; enfin, le rapport de Joe avec une jeune fille, qui suit un cours totalement prévisible.
Mais peu importe les petites objections qu’on peut avoir à l’égard Des diables et des saints. Ce livre engage le lecteur du début à la fin, jusque dans les petits détails. Les personnages sont captivants et d’une humanité émouvante. Joe, certes, mais aussi ses amis, que je vous laisse découvrir. L’écriture d’Andréa est fine, pointue, et lumineuse sans être prétentieuse. L’humour est présent, mais subtil et conforme à la personnalité de Joe. Le sujet, lourd – les abus subis par des enfants confiés à des institutions censées les protéger -, est traité avec doigté et fidélité au contexte historique. Et, bien que ce contexte remonte à plus d’un demi-siècle, le sujet reste d’actualité.
Lisez ce roman, vous ne serez pas déçus.
*
Jean-Baptiste Andrea
Des diables et des saints
Editions L’Iconoclaste
2021
Nous l’avons lu en collection Proche.
Tous nos articles sur Andrea sont référencés dans le classement par auteur.