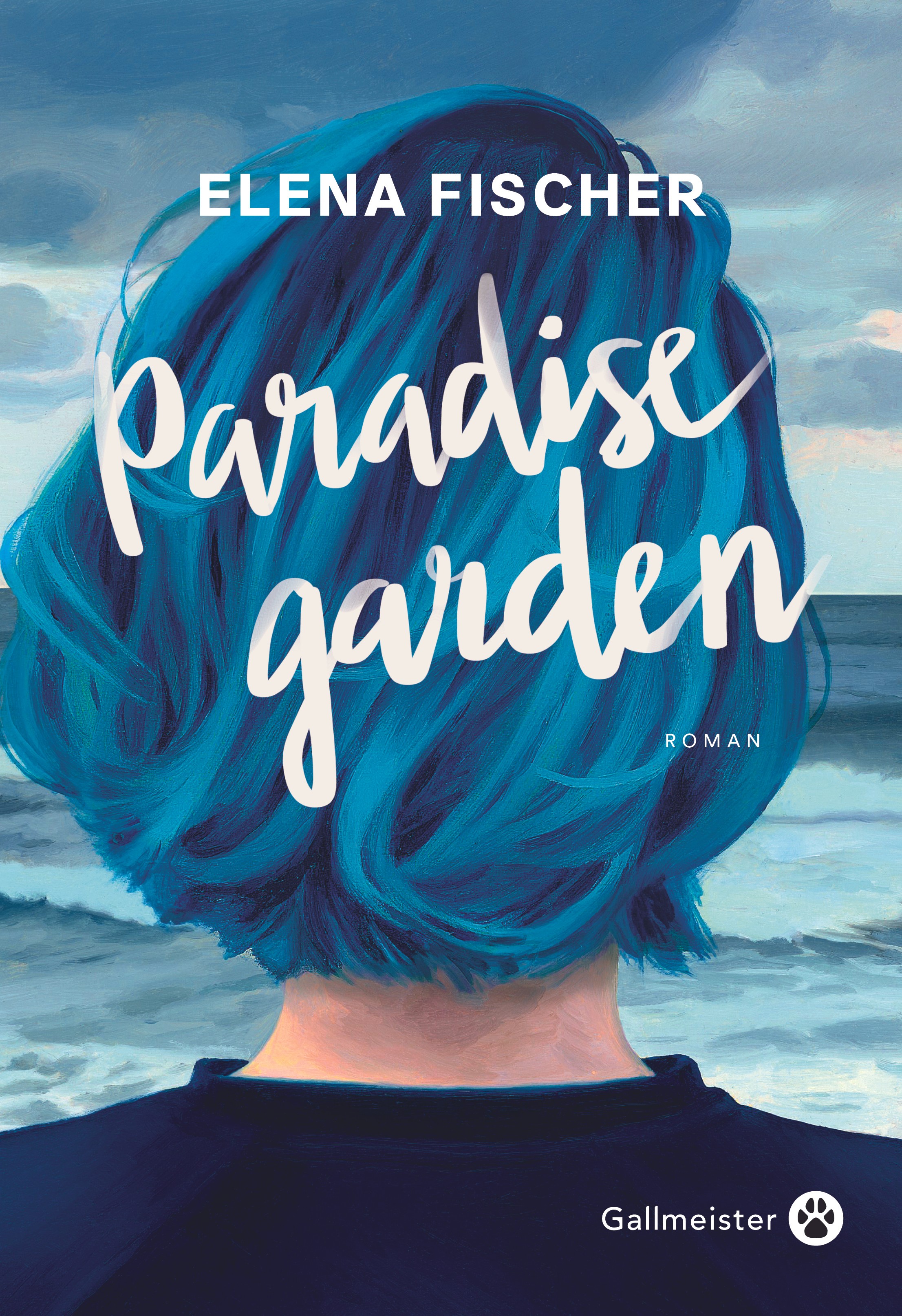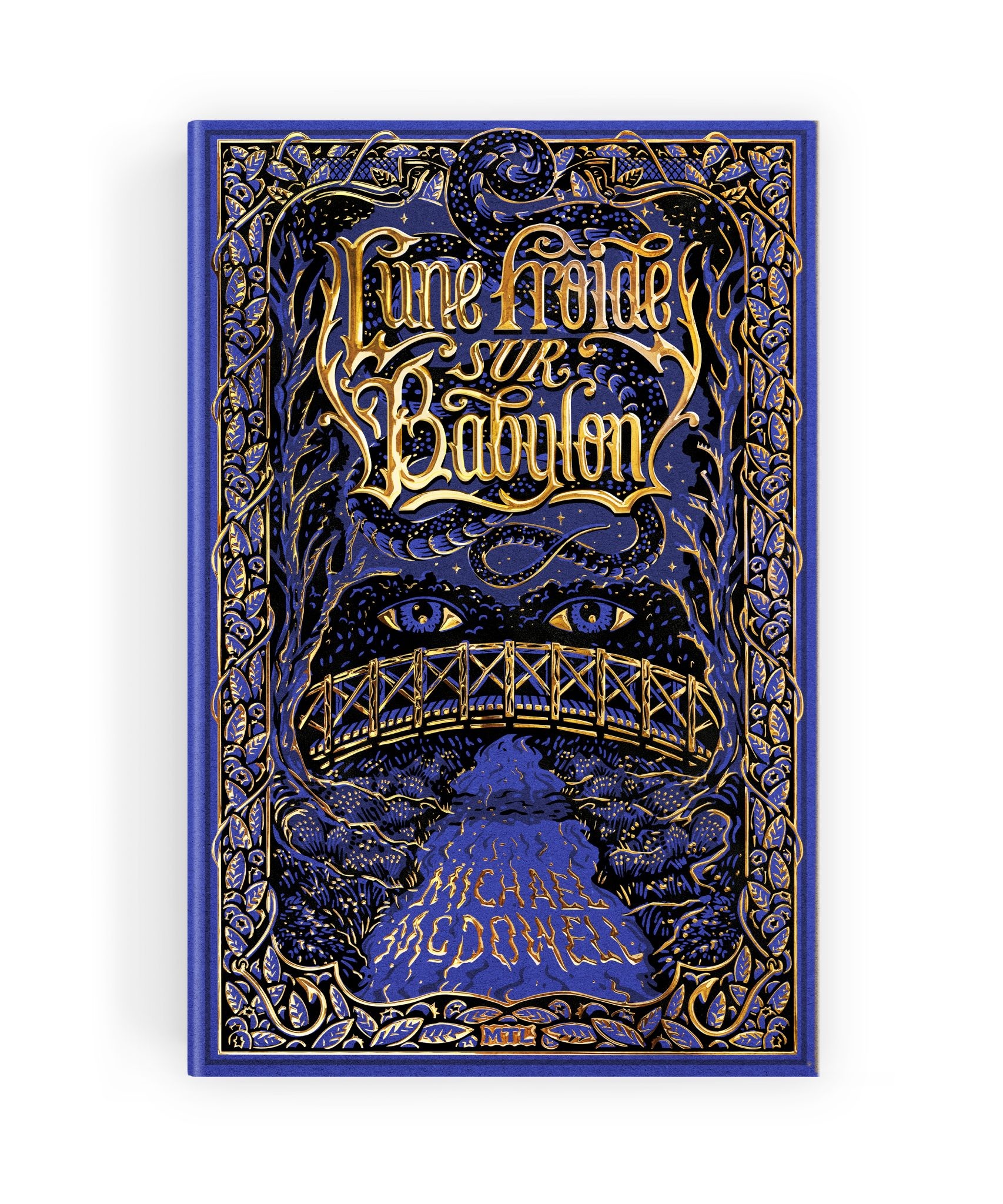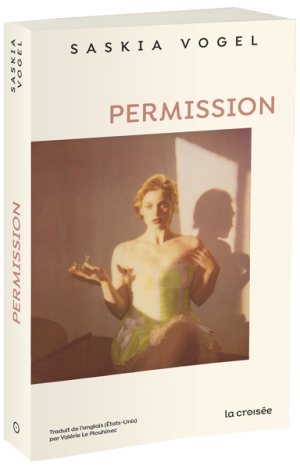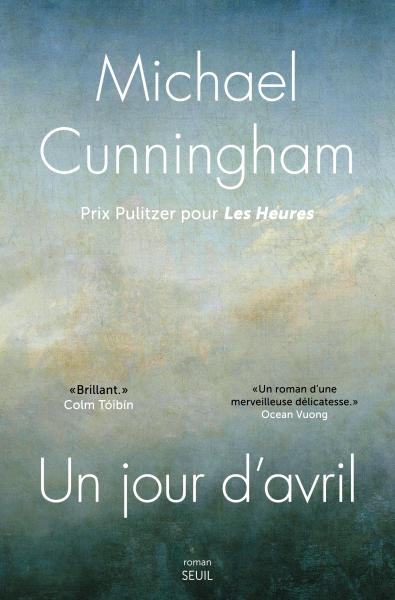—
Littérature américaine
Par François Lechat
Inconnu du public francophone, Henry Wise, auteur de poésie jusqu’ici, a obtenu l’Edgar Award 2025 du meilleur premier roman américain pour Nulle part où revenir, et cela se comprend.
Au départ, la trame paraît simple. Après dix années passées en ville, à Richmond, Will Seems revient dans son trou perdu de Virginie, dans une région marquée par la ségrégation raciale, la drogue, une nature aussi étouffante que luxuriante, la foi en Dieu et les croyances surnaturelles. Devenu adjoint d’un shérif buté, il enquête sur le meurtre présumé d’un ancien voisin et ami, dont le coupable désigné, un Noir, est innocent à ses yeux car il le connaît bien.
Tout le monde, en fait, est lié à tout le monde dans ce jeu de pistes prenant, qui tisse des rapports complexes entre les personnages : amitié, culpabilité, sororité, vengeance, désir, ambivalences familiales… Aucun héros, ici, Will Seems multipliant les erreurs, tandis que sa comparse, une policière black écartée de son poste, joue au bulldozer au risque de faire foirer leur enquête. Mais pas de coupable absolu non plus, ceux qui dérapent traînant un passé douloureux.
Personnellement, même si certains décors sont saisissants, la beauté des descriptions m’a laissé assez froid. Mais j’ai beaucoup aimé l’épaisseur et l’humanité des personnages, y compris féminins, ainsi que la complexité des relations qui les rendent prisonniers les uns des autres sans empêcher l’espoir. Et si le dénouement paraît fatal après coup, tant l’auteur tisse habilement sa toile, l’incertitude règne jusqu’au bout.
Plus qu’un polar rural, une sorte de tragédie grecque.
*
Henry Wise
Nulle part où revenir
Traduction : Julie Sibony
Sonatine
2025