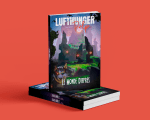Philippe Grimbert, Les morts ne nous aiment plus, Grasset, 2021
— Par Anne-Marie Debarbieux
Écrivain et psychanalyste, Paul est devenu un spécialiste de la question du deuil. C’est le thème de nombreuses conférences qui lui valent une grande notoriété et l’intérêt d’un large public. Cependant, après la mort tragique d’Irène, son épouse, Paul n’échappe pas à la règle commune en découvrant que, confronté lui-même à la perte d’un être cher, submergé par le chagrin, il n’est pas plus armé qu’un autre pour faire face à la tragique douleur de l’absence, de la solitude et d’un sentiment de culpabilité de n’avoir « rien vu venir », trop occupé par sa passion pour son métier et les affres de son inspiration littéraire. La consolation est d’autant plus difficile et complexe qu’elle laisse entrevoir la possibilité de vivre sans l’autre ce qui peut engendrer une certaine forme de culpabilité.
C’est alors que, contre toute attente, Paul, qui ne croit en aucun au-delà réconfortant, finit par se laisser convaincre par un étrange personnage qui prétend, en dehors de toute référence religieuse ou de toute forme de croyance ou de magie, lui donner le moyen de retrouver avec son épouse disparue un lien qui l’aidera à vivre sans elle. Paul est vulnérable, au nom de l’éternel conflit entre la raison et le « mais quand même ? » qui susurre que l’impossible est peut-être possible.
De quoi s’agit-il ? Les « consolateurs » et marchands d’illusions parfois très lucratives mais très attractives sont-ils plus dangereux aujourd’hui qu’hier ? C’est évidemment le centre du roman.
Ce livre, très bien écrit, n’est sans doute pas le meilleur de Grimbert mais il est néanmoins passionnant et n’est pas sans évoquer la série remarquable « En thérapie » diffusée sur Arte : bien construit, il met en scène un nouvel Orphée en quête d’impossible retour de l’être cher vers le monde des vivants. Aussi nombreuses que soient les hypothèses en ce domaine la question du lien entre le monde des morts et celui des vivants reste au cœur de l’humanité.
Catégorie : Littérature française.
Lien : chez l’éditeur.