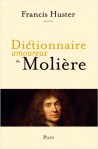— Par Catherine Chahnazarian
Georges Forestier, Molière, Gallimard, 2018
Il en parle mieux lui-même, mais je tenais à vous présenter cette biographie passionnante et précieuse.
Passionnante parce qu’en racontant la vie de Molière et la chronologie de sa production théâtrale, Forestier nous plonge bien sûr dans l’époque, la vie d’artiste sous Louis XIV ; il nous plonge aussi dans une carrière, qui se construit sous nos yeux entre amis et concurrents, soutiens et difficultés ; il nous fait voir ce génie s’épanouir, innover, oser, connaître la gloire, et mourir bêtement « d’une infection pulmonaire qui a emporté des centaines d’autres Parisiens en février 1673 ».
Précieuse car Georges Forestier, historien, professeur à la Sorbonne, raconte Molière d’après des bases solides, en s’appuyant sur tout sauf les légendes et en jetant aux orties les mythes propagés par Grimarest, son premier « biographe » — comme on ne disait pas à l’époque (1705). Ce qui fait de ce Molière-ci une référence pour ceux qui s’intéressent à l’auteur et au comédien, ou au théâtre du XVIIe siècle, pour les enseignants qui voudraient ne pas dire de bêtises à leurs élèves, et pour tous ceux qui préfèrent les vérités aux mythes.
Il en parle mieux lui-même dans cet entretien (42’54), une sorte de cours sans façon, vivant et captivant, érudit et facile à suivre, dans lequel, après s’être présenté, il raconte au débotté, en expliquant sa démarche, un tas de choses sur Molière, sur L’École des Femmes et Tartuffe (notamment), comment on peut raisonner sur son oeuvre, le fonctionnement des théâtres à l’époque…
Génial.
Dans un tout autre genre, j’en profite pour signaler :
Francis Huster, Dictionnaire amoureux de Molière, Plon, 2021
Dans ce patchwork d’analyses, de récits, d’explications, de ressentis, et de savoirs transmis de génération en génération de comédiens, le plus intéressant est ce regard d’homme de scène qu’a Francis Huster sur Molière. De ce point de vue, cet ouvrage complète l’apport de Georges Forestier. On peut regretter la dédicace à l’élite du théâtre français, comme si les petites troupes et les amateurs n’étaient que comédiens de pacotille indignes du grand homme, et la forme stéréotypée et commerciale du « dictionnaire amoureux ». Mais il faut reconnaître à Francis Huster une connaissance profonde des pièces de Molière du point de vue de la scène, de l’incarnation, du jeu et des ficelles.
Catégories : Biographies et autobiographies (France).
Liens : le Forestier chez son éditeur ; le Dictionnaire amoureux chez le sien.