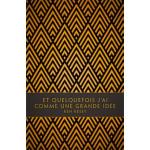Tracy Chevalier, Le Nouveau, Phébus, 2019
Par Anne-Marie Debarbieux.
Sollicitée parmi d’autres auteurs pour marquer le 400ème anniversaire de la mort de Shakespeare par la réécriture de l’une de ses pièces, Tracy Chevalier accepta avec enthousiasme ce défi en choisissant de transposer Othello. Le Nouveau se présente donc comme une adaptation de la tragédie dont elle respecte l’unité de temps (une journée, découpée en cinq moments), l’unité de lieu (une école primaire des environs de Washington), l’unité d’action (la première journée d’un nouveau en CM2).
Le nouveau, c’est Ossei, dit O, fils d’un diplomate ghanéen, habitué aux fréquents changements d’école, à l’accueil réservé voire hostile qui salue l’arrivée d’un enfant noir, contraint de toujours rester sur ses gardes, se débrouiller seul, et ne se pas s’offusquer de comportements racistes, intentionnels ou maladroits.
Sauf que cette fois, O est accueilli avec beaucoup de gentillesse par Dee, la fille la plus appréciée de toute l’école. Soulagé et heureux, il ignore que cela va déclencher immédiatement la colère de Ian, maître incontesté et redouté de la petite communauté des CM2 et champion de la manipulation.
Jeux de ballons, cordes à sauter, refrains fredonnés dans les rondes, escalade de cages à poules, chuchotements et éclats de rire, le microcosme d’une cour de récréation ordinaire n’est pas pour autant une image du paradis. Il y règne des lois, des petits chefs, des enjeux de pouvoir, des jeux de séduction ou d’exclusion, des codes et des secrets. L’intérêt du roman est d’explorer cet univers faussement innocent en attribuant tous les rôles principaux à des enfants.
Très intéressant également, le choix d’un enfant noir dans une école où tous les autres sont de race blanche, ce qui permet au lecteur de mesurer les préjugés et ignorances qui sont le terreau du racisme ordinaire.
Une réserve cependant pour ce roman, à bien des égards intéressant, mais c’est une réserve non négligeable : on peine à croire que ces enfants n’aient que 10-11 ans. Le langage tout comme l’évolution des situations (couples qui se font et défont, baisers volés, jalousies), tout cela resserré dans l’espace temporel d’une journée de classe, évoque davantage des pré-ados de 12-14 ans (d’autant que l’action se situe vers 1970). On peut conclure que cette histoire n’est pas vraiment crédible. Sans doute, mais il s’agit d’abord d’un jeu littéraire, plutôt réussi à mon sens.
Catégorie : Littérature anglophone (U.S.A.). Traduction : David Fauquemberg.
Liens : chez l’éditeur.