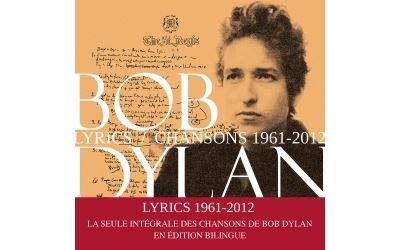Série : NOS MONUMENTS DE LA LITTÉRATURE AMÉRICAINE
–
————————–
Par Marie-Hélène Moreau
Si ce n’est pas pour ce livre que Norman Mailer a remporté le prix Pulitzer (mais pour Le chant du bourreau), Les nus et les morts reste un monument de la littérature américaine, tout comme son auteur lui-même, qui reçut, entre autres, le National Book Award pour l’ensemble de son œuvre.
Considéré comme l’un des meilleurs romans sur la Seconde Guerre mondiale, Les nus et les morts suit un groupe de soldats en poste sur une petite île du Pacifique tenue par les Japonais. Récit étourdissant de plus de sept cent pages, il alterne le quotidien d’une base militaire perdue dans la jungle, les scènes de guerre mais aussi, en flash-back éclairants, la vie civile des différents protagonistes. Ces trois éléments forment un tout indissociable qui immerge totalement le lecteur dans la folie de la guerre. C’est particulièrement frappant dans la description d’une hiérarchie militaire insensible au sort de ses hommes et uniquement préoccupée par son avancement.
Écrit alors que l’auteur n’avait que vingt-cinq ans, le livre est bluffant de maturité et de réalisme, mais il est vrai que Norman Mailer a lui-même servi dans le Pacifique. On ressent à travers ces pages la chaleur étouffante, l’ennui lié à l’attente, les bestioles qui pullulent et l’ennemi qui rôde. On ressent également la peur terrible de ces hommes envoyés à l’autre bout du monde sur une terre qu’ils ne connaissent pas et dont ils n’ont rien à faire. Et c’est réellement l’une des forces du livre de nous renvoyer ponctuellement à la vie civile de chacun des principaux personnages, simple soldat ou gradé. Difficultés économiques, travail, relations amoureuses… L’occasion pour l’auteur de brosser un tableau acide de l’Amérique de l’époque, entre lutte des classes – qui se poursuit jusque dans la guerre –, discriminations diverses – notamment l’antisémitisme dont Norman Mailer a lui-même souffert – et sexisme rampant. Raconté au plus près de ces hommes, le récit en est d’autant plus incarné.
La longueur du livre peut certes rebuter (688 pages) mais n’hésitez pas. Rien n’est en trop, et vous serez happés par cette fresque violente et terriblement humaine. Un chef-d’œuvre qui n’a pas pris une ride, ni dans son écriture, ni dans les thèmes qu’il aborde.
*
Norman Mailer
Les nus et les morts
Traduction : Jean Malaquais
Éditions Albin Michel
1950
Titre original : The Naked and the Dead
Éditions Rinehart & Company
1948